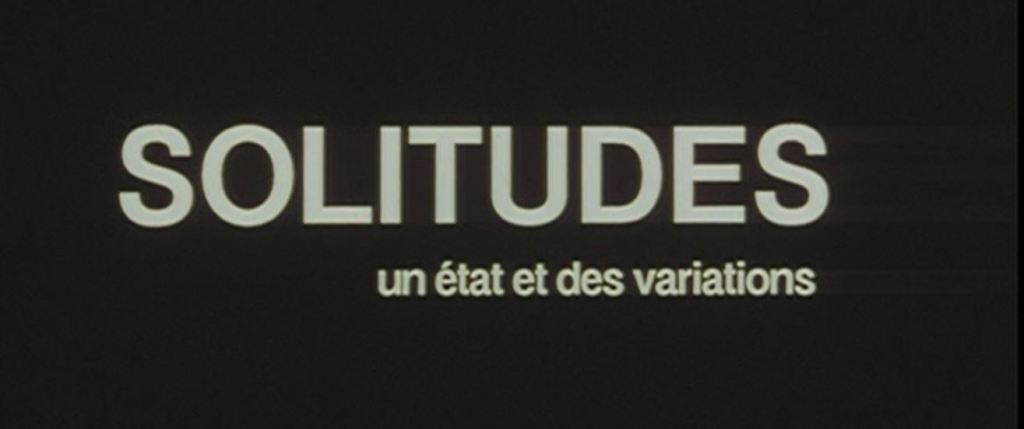.
A tous égards, la répétition, c’est la transgression.
Elle met en question la loi, elle en dénonce le caractère nominal ou général,
au profit d‘une réalité plus profonde et plus artiste.
Gilles Deleuze
,
L’art d’Akerman est un art de la subtilité. Elle interroge les petits événements silencieux, les mouvements imperceptibles, les drames du quotidien chuchotés en catimini. Toute une nuit pratique plus que jamais cet art de la finesse en s’attaquant au thème le plus vieux du monde : l’amour. Akerman y va tout en douceur, pas à coups de marteau, mais avec une lime très effilée. Et autour de cette étreinte amoureuse qui est l’image matricielle du film, elle démultiplie les variations. Comme dans les Variations Goldberg certains éléments se poursuivent, d’autres se font écho, d’autres encore se dissolvent, engloutis par le mécanisme de la répétition. L’échancrure de la robe rouge d’Aurore Clément résonne avec celle d’une autre femme dévorée par l’attente au fond d’un café, les mêmes taxis arrivent et s’en vont, les mêmes portes sont à un moment théâtre d’un adieu, à un autre, lieu d’une retrouvaille. Ce qui compte, alors, est de capturer le secret de ces instants décisifs, où la parole fait défaut, où tout se joue dans un regard, un geste. Dans la prolifération de ces bribes de fiction, la cinéaste belge nous montre ce qu’elle connaît le mieux : un certain savoir du corps. Le corps avec ses gaucheries et ses maladresses, le corps dans ce qu’il a de non-maîtrisé quand il succombe à l’urgence du désir. A partir de ces marionnettes dont on nous cache aussi bien le passé que le futur, Akerman fait sortir quelque chose de burlesque et de dramatique à la fois, quelque chose d’ineffable qui ne réside ni dans leur singularité psychologique ni dans leur universalité. Et pourtant, presque par magie, on perçoit l’odeur de ces corps trempés de sueur, brisés de fatigue, vibrants d’émotion, dans cette nuit bruxelloise, une de ces torrides nuits d’été, pas différente des autres, pas tout à fait la même. Une nuit peuplée d’insomniaques, de petites filles qui s’échappent pour de bon, avec pour seul compagnon un chat, de femmes qui font leur valise, de mères qui trouvent enfin le temps de fumer une cigarette, mais pas jusqu’au bout, car leur proches ne cessent de les réclamer. C’est la nuit des amoureux bien sûr, une nuit d’attente et de désir. L’attente qui consomme, le désir qui ronge. Ces silhouettes fragiles bougent au rythme bizarre de leurs attractions et répulsions, brûlant d’amour comme des personnages sortis d’un roman de Duras. Ce ballet d’ombres a pourtant une caractéristique singulière : il n’a pas peur de jouer avec le cliché, car, à force de recommencements et d’itérations, d’assonances et de reflets entre les images et les motifs qui forment celles-ci, le poncif est comme déshabillé, démonté dans son fonctionnement, et livré alors à une nouvelle prolifération de sens. Le spectateur se trouve en face de ces scénettes d’amour, si banales et pourtant si singulières, et il ne peut qu’être frappé par ce regard si insolite sur une matière si familière. Car l’agencement inaccoutumé de ces motifs a le double pouvoir de faire le ménage de tout le rabâchage qui hante notre imaginaire collectif, et de réactiver nos souvenirs les plus intimes, les faisant ressurgir à l’esprit par le biais de cette petite madeleine cinématographique, à la saveur aigre-douce. Quel est alors le secret de cette recette, aux charmes si puissants, qui nous fait rester englués à l’écran malgré l’absence d’intrigue, d’histoire, de récit ?
On a presque envie de répondre avec la distinction autrefois marquée par Pasolini entre « cinéma de prose » et « cinéma de poésie » et de se hasarder à dire que le stylo d’Akerman fait de la poésie car son idée très musicale du montage active des correspondances inédites, des allitérations inusitées. Ce n’est pas un hasard, en effet, si, comme le dit Akerman même, « pendant le montage on écoutait les images (sans le son) aussi bien qu’on les regardait »2.
Par ailleurs, dans cette balade bruxelloise, clin d’œil au film symphonie de la ville à la Ruttman, mais aussi aux chorégraphies de Pina Bausch, on mélange des styles différents et on prend des risques par rapport aux choix esthétiques pratiquée auparavant: Tout une nuit, tout en conservant une certaine symétrie et rigueur du cadre typiques des années soixante-dix, est un film qui s’oppose
à ceux qui le précédent par sa tentative d’échapper à la maîtrise d’un Jeanne Dielman, ou à la posture théorique des Rendez Vous d’Anna. C’est peut-être ce côté un peu sauvage, presque barbare du film qui l’empêche de tomber dans le piège de la mièvrerie, du déjà-vu ? En tout cas, ce diamant brut, filmé à la hâte sans sous ni moyens, en 16mm et son direct, inaugure une phase nouvelle dans la cinématographie de l’auteure, plus ouverte aux tons de la comédie, aux allures de la légèreté, aux charmes du hasard.
Entre Tati et le mélodrame, entre improvisation et canevas, singularité et universalité, anti-naturalisme et fiction, ce film déjoue les attentes du récit progressif et linéaire sans pourtant tomber dans l’aspérité du structuralisme minimaliste, et entame une pratique de l’hybridation et de la greffe qui caractérisera Golden Eighties ou Portrait d’une jeune fille de la fin des années soixante à New York. Une écriture de l’entre-deux donc, qui rend creuses les oppositions binaires, car entre l’accumulation a-téléologique des fragments et la ligne progressive qui va du crépuscule au matin il n’y a pas friction, mais plutôt imbrication. Ou, pour le dire autrement, une écriture du seuil, car au-delà de l’image fusionnelle de l’étreinte amoureuse, c’est l’espace interstitiel de la frontière qui nous hante après le film. Ces portes, ces fenêtres qu’on ne cesse de traverser, de fermer, de claquer, d’entrouvrir, sont, à mon sens, littéralement et métaphoriquement le lieu d’une tension entre actualité et potentialité, désir et négation. Mais, encore une fois, Akerman dépasse la dialectique qui voudrait une synthèse entre le principe de plaisir nocturne et le principe de réalité qui gagne la belle à l’aube, car la réalisatrice s’amuse à brouiller les cartes et nous laisse en proie à ce merveilleux pas de deux en avant de la scène finale, qui trace dans nos esprits comme l’hypothèse d’une ligne de fuite, projeté qu’il est vers d’autres devenirs possibles.